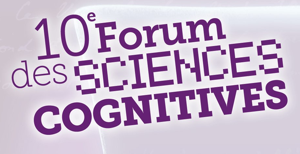Mini-conférences - Débats
•
(13h30) Georges Chapouthier, "Intelligence animale et approches de la vérité"
Les progrès de l’éthologie montrent que l’intelligence des animaux les
plus performants est beaucoup plus grande que ce qu’on avait longtemps
cru. Ils permettent d’imaginer des racines animales pour la « vérité »
sous toutes ses formes : vérité scientifique (conformité au réel),
vérité personnelle (conviction), voire, peut-être, vérité morale (sens
de la justice)
Georges
Chapouthier est ancien élève de l'École normale supérieure, aujourd'hui
directeur de recherche au CNRS, Centre Emotion, USR CNRS 3246, Hopital
Pitié-Salpêtrière, chercheur associé à l'IHPST (Institut d'Histoire et
de Philosophie des Sciences et des Techniques. CNRS, ENS, Université
Paris I). Il a une double formation de biologiste et de philosophe. Ses
spécialités sont, en biologie, la pharmacologie de la mémoire et de
l'anxiété et, en philosophie, les rapports de l'humanité et de
l'animalité. Paru chez Belin en 2009, l'un de ses derniers ouvrages,
Kant et le chimpanzé, traite de la continuité entre animal et être
humain, et des racines « naturelles » de concepts aussi évolués que
l'art et la morale.
• (14h) Sylvie Chokron & Jean Ponce, "Comprendre une scène visuelle : vision naturelle et vision artificielle"
L’illusion
de voir.
Quel est le rôle
de la cognition dans la perception ? Comment on apprend à voir ? Comment
désapprend-t-on à la suite d’une lésion ? Que nous apprennent les
pathologies sur la perception ?
Sylvie Chokron est
Directeur de Recherches, CNRS et responsable de l’Unité Fonctionnelle Clinique et Recherche, ‘Vision et Cognition’, de la Fondation
Ophtalmologique Rotschild à Paris. Ses
activités de recherche se caractérisent par une démarche expérimentale
plurielle tant par les approches utilisées (neuropsychologie,
psychologie expérimentale, modélisation, imagerie cérébrale
fonctionnelle) que par les sujets testés (normaux : enfants, adultes,
personnes âgées, gauchers ou droitiers, patients cérébrolésés ou
souffrant de troubles psychiatriques) et les buts poursuivis : étude des
processus impliqués dans la cognition spatiale, mais également de leur
développement et de leur involution à la suite du vieillissement
cérébral normal, d’une lésion cérébrale ou d’un trouble psychiatrique.
Cette démarche pluridisciplinaire (neurosciences cognitives, cliniques
et computationnelles) lui permet d'allier recherche fondamentale et
recherche clinique dans le domaine de la cognition visuelle et spatiale.
Jean
Ponce,
Professeur au Département d'Informatique de l'École Normale
Supérieure, spécialiste de la vision artificielle.
Jean Ponce est professeur au département d’informatique à l’Ecole
normale Supérieure et professeur adjoint au département d’informatique de l’Université d'illinois à Urbana Champaign, aux Etats-Unis. Il est responsable de
l'équipe-projet WILLOW commune à l'ENS, à l'INRIA et au CNRS, qui cherche à comprendre les
mécanismes de reconnaissances visuelles, et à développer à terme les bases
d’une vision artificielle.
•
(15h) Gloria Origgi, "Pourquoi est-il si grave de mentir?
Du mensonge en philosophie."
La question philosophique de la
légitimité du mensonge est ancienne : est-on jamais justifié à mentir ? Y a-t-il des circonstances où
un mensonge est moralement supérieur à une vérité, en permettant, par
exemple, d’éviter un mal plus grave ? Et qu’est-ce que précisément mentir ? Est-ce
qu’une plaisanterie, une 'connerie' ou un baratin sont des mensonges? Est-ce que
cacher la vérité en ne disant rien, omettre des informations, signifie mentir?
Est-ce qu’un désintérêt pour la vérité est une faute morale, ou la faute morale
est-elle seulement à attribuer à ceux qui connaissent la vérité et pourtant
mentent?
Chargée de recherche
au CNRS et à l’Institut Jean Nicod, Gloria Origgi s’intéresse à
l’épistémologie sociale, à l’épistémologie du web, et à la philosophie
des sciences sociales. Elle a dirigé le projet Interdisciplines
(http://www.interdisciplines.org), portail de conférences virtuelles en
sciences humaines, et a conçu le colloque web Text-e
(http://www.text-e.org) avec le secours du Centre Pompidou et de la
société GiantChair.
•
(15h30) Catherine Vidal &
Simone Gilgenkrantz, "
Le cerveau a-t-il un sexe ?"
Les femmes sont-elles « naturellement » douées pour le langage et les
hommes bons en maths? Nos aptitudes et nos personnalités seraient-elles figées
dans le cerveau depuis la naissance? Les recherches récentes montrent au
contraire que, grâce à ses formidables propriétés de « plasticité », le cerveau
fabrique sans cesse des nouveaux circuits de neurones en fonction de l’ apprentissage
et de l’ expérience vécue. Ce débat traitera des apports des
neurosciences pour comprendre le rôle de la biologie et de l’environnement socio-culturel
dans la construction de nos identités d’ hommes et de femmes.
Catherine Vidal est neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur. Ses recherches portent sur la mort neuronale dans les maladies à prions. Elle se consacre aussi à la diffusion du savoir scientifique concernant en particulier les préjugés idéologiques sur le cerveau, le sexe et le déterminisme en biologie. Elle a publié : "Cerveau,sexe et pouvoir", Belin, 2005 ; "Hommes, femmes : avons-nous le même cerveau ?", Le Pommier, 2007 ; "Nos enfants sous haute surveillance", avec Sylviane Giampino, Albin Michel, 2009 ; "Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ?", Le Pommier, 2009.Simone Gilgenkrantz,
professeur émérite de génétique humaine au C.H.U. de Nancy. Elles sont co-auteurs de l'article Cerveau, sexe et préjugés.