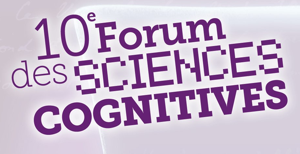Le programme de la journée est disponible
ici !
Pour télécharger la plaquette
cliquez ici !
Conférences
•
(09h45) Pierre Jacob, "À quelles conditions peut-on former une croyance vraie sur une croyance fausse d'autrui ?"
Les philosophes et les logiciens se sont posés les questions suivantes : Que veut dire le mot "vrai"? Quelle propriété exprime-t-il? À quoi attribue- t-on cette propriété? Quelle est la différence entre le fait d'attribuer à autrui une connaissance et une croyance? Peut-on attribuer à autrui des croyances ou des connaissances sans posséder la maîtrise d'une langue naturelle. Depuis une bonne trentaine d'années, les sciences cognitives abordent certaines de ces questions à travers l'étude des capacités des jeunes enfants humains et celles des primates non humains à attribuer des connaissances et des croyances fausses. Je ferai le point sur l'état actuel des recherches sur l'attribution des croyances fausses à autrui chez des bébés préverbaux.
Pierre Jacob (1949) est ancien élève de l'ENS de Saint Cloud et agrégé de philosophie (1972). En 1978, il obtient le PhD du département d'histoire des sciences de l'université de Harvard où il a séjourné entre 1973 et 1978, grâce à une bourse de la Fondation Harkness (1973-1975). A partir de 1980, il entre au CNRS où il est chargé de recherche. Entre 1980 et 1988, il est membre du Séminaire d'épistémologie comparative de l'université d'Aix-en-Provence dirigé par Gilles Granger. En 1988, il devient membre du CREA de l'Ecole Polytechnique dirigé par Jean-Pierre Dupuy. Promu DR2 en 1994, il est responsable de l'EP 100 du CNRS créée en 1995 par la section 29 du CNRS. Depuis 1998, il est membre de l'Institut des sciences cognitives de Lyon dirigé par Marc Jeannerod. Ses travaux ont évolué de la philosophie générale des sciences vers la philosophie du langage, et de la philosophie du langage vers la philosophie de l'esprit et des sciences cognitives. Entre 1985 et 1990, ses travaux ont porté principalement sur les arguments en faveur d'une conception externaliste du contenu des représentations mentales. Entre 1990 et 1995, il a abordé deux problèmes complémentaires dans le cadre d'une compréhension naturaliste de l'esprit humain: le problème de la naturalisation du contenu des représentations mentales et le problème de l'efficacité causale du contenu mental dans l'explication des comportements intentionnels. Depuis 1995, dans le cadre de l'EP 100 et de l'Institut des sciences cognitives de Lyon, il a noué une collaboration avec des chercheurs en neurosciences cognitives dans le but d'analyser les conséquences de l'étude de la transformation visuo-motrice sur le sens même du mot "voir". Il est actuellement président de la Société Européenne de philosophie et psychologie.•
(11h) Francis Eustache, "
La mémoire humaine : entre exactitude et transformations"Les
modèles théoriques et les représentations de la mémoire humaine sont étroitement liés à l’étude de ses pathologies. Historiquement, les
syndromes amnésiques y ont joué un rôle prépondérant mais les
investigations s’étendent aujourd’hui à divers troubles
neuropsychiatriques où le déficit mnésique n’est pas au premier plan. La
mémoire n’est plus conçue comme un simple « instrument » mais comme une
structure d’interface, nécessairement changeante, avec notre identité
et le monde extérieur.
Francis Eustache est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, directeur de l’Unité de recherche Neuropsychologie Cognitive et Neuroanatomie Fonctionnelle de la Mémoire Humaine – Inserm – EPHE – Université de Caen Basse Normandie. Spécialiste en neuropsychologie de la mémoire humaine, il dirige à Caen des recherches sur les troubles de mémoire et le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives. Son dernier ouvrage « Les chemins de la mémoire », essaye de comprendre le fonctionnement de la mémoire depuis l’enfance jusqu’au vieillissement en parcourant les maladies de la mémoire qui permettent de comprendre la mémoire humaine elle-même.•
(16h45) Gilles Fénelon, "Quand le cerveau se fait son cinéma : hallucinations et illusions visuelles"Le monde visuel qui nous entoure ne se projette pas dans notre cerveau
comme sur un écran de cinéma : la vision se construit de manière active,
en fonction des informations externes mais aussi de processus internes,
liés à l'attention, à la mémoire et aux émotions. Nous sommes aussi
capables de générer des images internes, telles que celles du rêve. Ces
mécanismes complexes peuvent
être pris en défaut, aboutissant à une mauvaise interprétation d'un
stimulus externe réel, on parle alors d'illusion, ou par la création de
toute pièce d'une image irréelle, une hallucination. A travers quelques
exemples, nous essaierons de rendre moins impénétrables les voies de la
vision et ses aberrations.
Gilles Fénelon est neurologue au Groupe hospitalier universitaire Henri Mondor (AP-HP) à Créteil. Il est membre d’une équipe de recherche de l’INSERM (U955, Créteil)) et du Département d'études cognitives de l'Ecole Normale Supérieure (Paris). Son activité clinique et de recherche est centrée sur la maladie de Parkinson et les interfaces entre neurologie et psychiatrie, en particulier les hallucinations. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont Hallucinations, regards croisés.•
(18h) Raphaël Gaillard, "
Modèles cognitifs et neurobiologiques du délire"Qu'est-ce qui détermine l'émergence des idées délirantes et qu'est ce
qui amène à les maintenir en dépit de la contradiction que les faits
peuvent leur apporter ? A partir de ces questions cliniques, nous
présenterons les modèles cognitifs qui visent à en rendre compte, au
travers notamment de l'approche bayésienne de la cognition. Nous
chercherons à faire le lien avec les perturbations neurobiologiques
et/ou neurales qui sous-tendent ces phénomènes. Cette démarche nous
amènera à formuler l'hypothèse que l'incertitude a des effets
déterminants sur l'émergence et le maintien des idées délirantes.
Ancien élève de l'Ecole Normale Superieure, ancien interne des Hôpitaux de Paris, Raphael Gaillard est actuellement chercheur et psychiatre, maître de conférence des universités - praticien hospitalier dans le Service Hospitalo-Universitaire de Santé Mentale et de Thérapeutique du Centre Hospitalier Sainte-Anne et de l'Université Paris Descartes. Après une thèse de sciences sur les bases neurales de la conscience dans le laboratoire du Professeur Dehaene, il a été research associate dans la Brain Mapping Unit à l'Université de Cambridge sous la supervision du Professeur Fletcher. Il s’intéresse à la prise en charge des patients atteints de schizophrénie et de maladie bipolaire, et à la modélisation des symptômes psychotiques en combinant la psychologie expérimentale, la pharmacologie et l’imagerie.